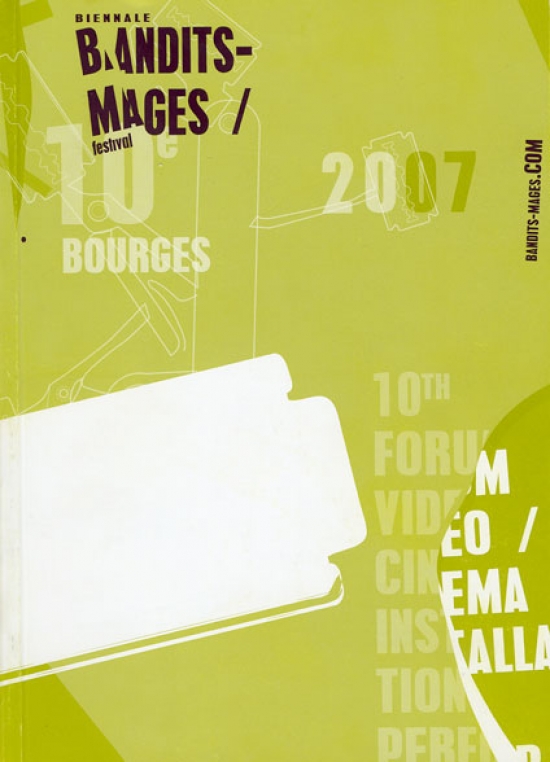
Chronique des musiques provisoires (1/2)
Catalogue
« Chronique des musiques provisoires (1/2) » in Isabelle Carlier et Jean-Pascal Vial, Catalogue de la dixième biennale Bandits-Mages, dir. par., Bourges, 2007.
Massive Attack, Paris, 2006. Derrière les ingénieurs du son et leur mur de consoles, derrière leur
« écran » d’écrans d’ordinateurs, à côté de moi, quelqu’un prend des photographies avec son téléphone portable : dans ce cadre digital, les curseurs numériques des volumes sonores donnent l’impression d’avoir été photographiés, non, ce sont au loin les jeux de lumières de la scène. Question d’échelles ? Ce concert de Massive Attack est un dispositif d’art contemporain. Des rectangles miniatures rouges, verts, blancs, violets, clignotent comme des immeubles verticaux phosphorescents, comme une constellation de sinusoïdes dans un cockpit, tandis que, sur scène, les basses mettent les sens à l’épreuve du son. Sensorielle, l’expérience de l’image et du sonore s’inverse, elle se détend comme un corps élastique et s’ouvre… Comme une galaxie venue d’en bas, des astres souterrains qui tournoient, un flux soudain, des déflagrations continues de métal, une nappe maintenant aérienne de claviers qui plonge, cette fois, le corps dans l’infini d’un univers bruitiste, tactile et surdosé qui monte le long des cinq sens. Tout s’y réunit, l’expérience iconique et plastique et celle du trip-hop, nous y voilà, il faut repartir en arrière, s’interroger sur le langage et sur le temps, et remonter l’histoire du rock à contre-courant, c’était au début, une autre histoire des sons, pour chaque adolescent, elle commence un jour ou l’autre et garde les traces, inavouées, de la forme autobiographique.
[…]
Mais de quel rock s’agit-il ? car le rock — qui peut inégalement accompagner et séduire au fil de ses modes et de ses esthétiques (Pixies me passionnera, le grunge non, avec le trip-hop tout recommencera, comme avec la new-wave, il y a vingt-cinq ans avec qui, d’emblée, tout avait précisément commencé) — le rock a toujours été pour moi un problème en tant qu’objet théorique. Non du point de vue de son évaluation artistique. Après la Beat Generation, le pop art ou l’inventivité graphique et modiste du punk (Malcolm Mc Laren, Vivienne Westwood), après Rock my Religion de Dan Graham qui établit, au fil d’un montage vidéo virtuose, une analogie entre les transes mystiques de communautés religieuses comme celles des Shakers et l’extase survoltée des concerts rocks, après les pochettes de disques ou livrets de CD, faits de contributions d’artistes et de musiciens telles celles d’Andy Warhol et du Velvet Underground and Nico, 1967 ; de Bernd et Hilla Becher et de Kraftwerk, 1970 ; de Ralph Gibson et de Joy Division (Unknown Pleasures, 1979) ; de Art and Language et de The Red Crayola dans Kangaroo ? (1981) ou dans Black Snakes (1983) ; de Mike Kelley et de Sonic Youth (Dirty, 1992) ; après des films comme Blow-up de Michelangelo Antonioni, One + One de Jean-Luc Godard, Mystery train de Jim Jarmusch, Jusqu’au bout du monde de Wim Wenders, Lost Highway de David Lynch, Sombre de Philippe Grandrieux (pour Alan Vega), Last days de Gus Van Sant et Marie-Antoinette de Sophia Coppola, ce débat — qui a pu exister, il est vrai — n’en est plus un. Le rock délivre un corpus artistique autonome : visuel, textuel et sonore, mais aussi : sémiologique, politique et sociologique (image, corps, sexe, mœurs). Et puis, la question de l’énergie revendicatrice et visionnaire, même cousue de fil blanc (ou rouge, rose ou noir) fait son chemin de Graine de violence de Richard Brooks à The Dead Kennedys, via Woodstock à sa façon, tandis qu’elle est tendue, toujours cette question, inévitablement, par l’immense champ sociétal et cynique du politique (que seraient devenus les Beatles sans le fond monochrome de la Guerre froide ?).
Il n’en demeure pas moins que sur la musique rock en tant qu’objet théorique (précaution méthodologique), je butte. D’abord, et sans naïveté, oui, à cause de l’argent, à cause de la mobilisation de l’argent pour en faire un éternel recommencement, car la pression médiatique d’une musique devenue marchandise manipule si subtilement qu’elle peut annihiler le jugement critique : le rapport de force est trop inégal. Or, s’il faut penser cette manipulation (après tout, en soi, rien de très nouveau, l’art n’est qu’illusion), les rouages de la perception du rock se découvrent comme essentiellement spécieux. Voici l’écueil ! C’est en général adolescent que l’on découvre le rock, son apparition s’accompagne donc d’un certain émoi, celui des corps, du désir, des sens, de dépressions parfois, d’intensité en creux (l’ennui), mais aussi des engagements, des révoltes et des premiers choix constitués, des expériences artistiques inédites, irrévocables, en un mot : à l’âge où le présent fait de fulgurance, d’incandescence, de sensations mythiques, d’ébranlements, de chaos est perçu comme irréel. Et le rock va initier parfois, stimuler et déformer aussi (fonction de l’imaginaire selon Bachelard), accompagner souvent ces sensations. En garder constamment l’empreinte (y compris dans toutes les formes du passé récent), et réécouter plus tard ses musiques, c’est faire surgir l’anamnèse telle que la poétique la trouve et l’art l’active dans la littérature (Proust) ou le cinéma (La Jetée de Chris Marker).
De fait, dans mon histoire, le rock procède d’un temps magique, c’est en cela qu’il est profondément tragique, derrière ses apparences festives, hédonistes, il compose avec un souvenir actif dans le présent, une actualité reflétée par un passé toujours en devenir actuel. Donc, écouter du rock c’est ici, constamment, faire travailler le passé, et l’on ne peut l’écouter qu’en (re)construisant son portrait à l’instar du peintre d’Épilogue de L’Auteur et autres textes de Borges : il n’y a de rock qu’autobiographique, il n’y a d’écoute qu’en forme d’autoportrait. (Bryan Ferry au Grand Rex, en 2007, devant un public qui l’accompagne depuis la décennie 1970. À vingt ans, ces garçons et ces filles se rêvaient en Montgomery Clift ou en Ava Gardner, et, ce soir, l’ancien chanteur de Roxy Music les transfigure soudain, et lui-même, fort de cette illusion de bain de jouvence qu’il distille, irradie en retour, encore une fois, une nouvelle fois, il illumine son public : est-ce pour cela que les rockers ont des costumes de lumières ? pour le temps qu’ils font miroiter en dépit de toute logique spatiale ?) Ce n’est donc pas le présent qui se laisse annexer par le passé, mais l’inverse, c’est le passé qui fait retour en tant qu’autre présent dans le présent. Il m’est ainsi impossible de faire une histoire du rock impartiale, outre que j’en suis scientifiquement incapable, par définition, elle est mon histoire (mais la tâche est évidemment plus rude pour l’historien de la discipline, quand bien même il serait relativement objectif — ce qui n’est déjà pas sûr —, la perception de son lecteur s’y refusera de fait).
C’est ainsi que la fiction de Dorian Gray est très précieuse, elle fonde le temps même du rock (voilà pourquoi, dans les journaux, la métaphore de Dorian Gray vient-elle, si souvent il me semble, sous la plume des critiques), comme la photographie s’est attribuée le mythe de Méduse et le cinéma celui de La Caverne de Platon, le roman d’Oscar Wilde Le Portrait de Dorian Gray représente, pour toutes ces raisons, la relation du rock à un temps magique. Dès lors, ma gêne théorique se
précise : le jugement critique demeure logiquement biaisé voire faussé quand, tout à la fois, l’efficacité de la mobilisation promotionnelle, commerciale, marchande (l’argent) rencontre, du point de vue perceptif, le temps présent ou révolu de chacun qui, tôt ou tard, fait retour. Conceptuellement, une ambiguïté éthique apparaît à la conjonction de l’émotion et du commerce, l’un ripant sur l’autre. Et pourtant, le fait demeure, l’histoire du rock est bellement consistante, du point de vue artistique, sociologique et politique et aussi, précisément, par ce qu’elle résiste à se laisser appréhender en tant qu’objet théorique. Quelle(s) histoire(s) donc pour le rock ?
[…]
A. C.